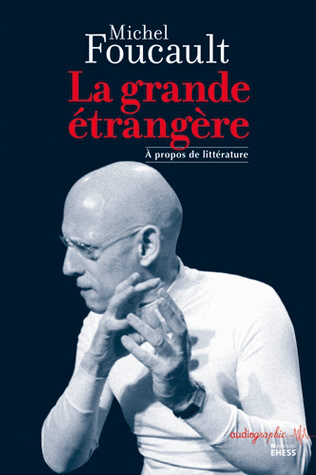Par Jean-François Vernay.
Il est des petites astuces éditoriales qui permettent de ravir les écrivains au repos éternel et de les faire parler d’outre-tombe. L’une d’entre elles, un grand classique, consiste à publier un manuscrit inédit à titre posthume pour donner suite aux instructions de l’auteur. C’est par exemple le cas de J. D. Salinger, auteur notamment de l’excellent Bildungsroman The Catcher in the Rye (1951), qui souhaiterait que cinq de ses manuscrits paraissent à compter de 2015. On peut aussi trouver un nègre officiel qui prolongera l’œuvre du maître, à l’image du nouveau père de James Bond qui publia Devil May Care (2008) avec en couverture la mention suivante : « Sebastian Faulks writing as Ian Fleming ». Il faudra bien qu’on m’explique cela un jour car, comme a coutume de dire une célèbre productrice du PAF, « je n’ai rien compris ». De même qu’il existe des galeries d’art pour exposer sans vergogne les « trésors cachés » des grands peintres – des croquis exécutés à la hâte, des ébauches d’œuvres, voire des gribouillages –, de même qu’il existe des éditeurs sans scrupules qui n’hésitent pas à aller à l’encontre des dernières volontés de grands pontes de la littérature afin de publier en l’état leurs œuvres inachevées, à l’occasion d’un centenaire par exemple. Toute ressemblance avec The Hanging Garden (2012), la publication d’un manuscrit entamé au tiers sous la plume du Nobel australien Patrick White, serait purement fortuite. Dans un même esprit, l’éditeur Max Brod alla à l’encontre des instructions laissées par son ami Franz Kafka pour publier avec force ajustements éditoriaux Le Procès (1925) puis Le Château (1926), entre autres. Mais La grande étrangère. A propos de littérature de Michel Foucault (1926-1984) procède d’une toute autre démarche.
Cette publication posthume s’inscrit dans un projet plus ambitieux : la collection audiographie pensée par Philippe Artières et Jean-François Bert. Il s’agit, pour ces deux historiens de l’EHESS, de recueillir la parole disséminée d’auteurs qui ont marqué leurs temps tout en ouvrant « une réflexion sur le rapport à l’écrit, aux mots, déterminants dans la circulation des savoirs ». Tout un programme auquel on adhère ! Les discours retranscrits dans cet ouvrage datent pour l’essentiel des années 1960. Ils furent prononcés entre la parution de Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical (1963) et L’Ordre du discours (1971), le neuvième livre de Michel Foucault. Les thèmes qu’il aborda jusque-là se résument à la folie (le sujet de sa thèse d’Etat présentée en 1961), les sciences humaines, le langage et la littérature. Et comme de juste, le premier volet de La grande étrangère porte sur « le langage et la folie » et comporte un entretien intitulé « Le silence des fous », mené par le metteur en scène et écrivain Jean Doat, et un monologue sur « Le langage en folie » dans lequel il est dit :
Eh bien, si nous avons du mal à communiquer avec les fous, ce n’est pas sans doute parce qu’ils ne parlent pas mais peut-être justement parce qu’ils parlent trop, avec un langage surchargé, dans une sorte de foisonnement tropical des signes où se brouillent toutes les allées du monde. (54)
Ces propos rejoignent l’excellente analyse de Jean-Jacques Lecercle pour lequel le délire « ne réside pas dans l’absence de signification […], mais dans sa saturation »[1]. C’est souvent la stratégie de la pensée de Michel Foucault que de retourner les situations les plus banales et les raisonnements les plus convenus, que de faire sourdre les paradoxes, que de surprendre là où le lecteur ne s’y attend guère en prenant par exemple le contrepied d’un truisme : le langage des fous n’est pas victime d’une absence de sens, comme on pourrait le croire, mais d’un trop plein de sens !
Le deuxième volet de La grande étrangère s’ouvre sur la dyade « Littérature et langage ». L’on notera chez Michel Foucault la propension à une pensée binaire, à coupler des paires complémentaires (en l’occurrence pour ce volet) ou antinomiques – une de ses marottes. Et le chantre de la contestation de mettre sur le doigt sur un autre paradoxe qui apporte des éléments de réponse à l’énigmatique ritournelle littéraire, qu’est-ce que la littérature ? (petit clin d’œil au passage à Jean-Paul Sartre), sans pour autant pouvoir trancher le nœud gordien :
Le paradoxe de l’œuvre, c’est précisément cela, qu’elle n’est littérature qu’à l’instant même de son commencement, [dès sa première phrase, dès la page blanche. Sans doute n’est-elle réellement littérature qu’en ce moment et sur cette surface, dans le rituel préalable qui trace aux mots leur espace de consécration.] Et par conséquent, dès que cette page blanche commence à être emplie, dès que les mots commencent à se transcrire sur cette surface qui est encore vierge, à ce moment-là, chaque mot est en quelque sorte absolument décevant par rapport à la littérature, car il n’y a aucun mot qui appartienne par essence, par droit de nature, à la littérature. (81-2)
Mais attendez quelques lignes, voire quelques pages, pour voir jaillir un autre paradoxe, un autre renversement de situations :
Et pourtant, en un autre sens, chaque mot, à partir du moment où il est écrit sur cette fameuse page blanche à propos de laquelle nous nous interrogeons, chaque mot pourtant fait signe. Il fait signe à quelque chose car il n’est pas comme un mot normal, comme un mot ordinaire. Il fait signe à quelque chose qui est la littérature ; chaque mot, à partir du moment où il est écrit sur cette page blanche de l’œuvre, est une sorte de clignotant qui clique vers quelque chose que nous appelons la littérature. Car, à dire vrai, rien, dans une œuvre de langage, n’est semblable à ce qui se dit quotidiennement. Rien n’est du vrai langage, je vous mets au défi de trouver un seul passage d’une œuvre quelconque que l’on puisse dire emprunté réellement à la réalité du langage quotidien. (84)
Dans un monde de l’édition en mutation, de plus en plus tourné vers la commercialisation d’une histoire plutôt que d’une griffe ou d’un style littéraire sui generis, Michel Foucault serait peut-être posthumement surpris de découvrir les nombreux passages de la littérature dite contemporaine où l’on pourrait peut-être se dire qu’ils furent inspirés de « la réalité du langage quotidien », notamment dans le cas de l’autofiction[2]. Mais au moment où il prononçait ce discours, l’autofiction n’était pas encore née. Foucault passe ensuite de l’analyse de la littérature à celle du discours critique, pour lequel il rédige une taxinomie autour du thème de la répétition, avec une schématisation qui pourrait heurter la sensibilité de ceux qui croient en la complexité de l’existence.
Le troisième volet de La grande étrangère incarne la posture critique du penseur poitevin en s’attaquant à l’œuvre de Sade[3] et en s’appuyant pour l’essentiel sur La Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. S’inspirant sans doute de l’intuition freudienne qui a largement contribué à propulser le rapprochement entre la sexualité et la créativité au rang de truisme, Foucault décèle des correspondances entre l’activité de création littéraire chez Sade et la libido sentiendi :
L’écriture, c’est le principe de la jouissance répétée ; l’écriture, c’est ce qui re-jouit ou permet de refaire. L’hédonisme de l’écriture, l’écriture comme re-jouissance, se trouvent ainsi marqués et tout ce qui, traditionnellement, dans la théorie littéraire classique du XVIIIe siècle, caractérisait le principe de l’intérêt croissant de l’écriture, le fait qu’on voulait toujours raconter les choses de manière que l’intérêt soit toujours soutenu, en réalité Sade en donne le principe et la racine sexuelle la plus radicale et la plus éhontée, c’est-à-dire l’écriture comme principe de recommencement perpétuel de la jouissance sexuelle. (165)
On l’aura compris aisément, je nourris une grande admiration pour Michel Foucault, non parce qu’il est, selon The Times Higher Education Guide, « l’auteur en sciences humaines le plus cité au monde » devant Pierre Bourdieu et Jacques Derrida, mais pour sa propension à se placer du côté de l’opprimé, du faible, de l’affligé, du stigmatisé, avec une méthode proprement foucaldienne : l’élaboration d’une archéologie du savoir qui repose sur la filiation et l’évolution historiques du sujet à l’étude.
NOTES
[1] Jean-Jacques Lecercle, Philosophy Through the Looking Glass (Illinois: Open Court, 1985), 3: “…as well shall see, the peculiarity of délire does not reside in its lack of meaning (the confusion of words involves the meaninglessness of the propositions uttered, but in its surfeit of it.”
[2] Lire Arnaud Genon, Autofiction : Pratiques et théories. Articles. Paris : Mon Petit Editeur, 2013.
[3] Voir aussi les analyses de Pierre Macherey sur Sade et Foucault in Philosopher avec la littérature. Exercices de philosophie littéraire. Paris : Hermann, coll. « Fictions pensantes », 2013.
Une contribution de Jean-François Vernay | Essayiste et chercheur en littérature, Jean-François Vernay est notamment l’auteur de Panorama du roman australien des origines à nos jours (Paris: Hermann, 2009) et La Séduction de la fiction (Paris: Hermann, 2019). Forteresses insulaires (Paris : Sans escale, 2022) vient de paraître.
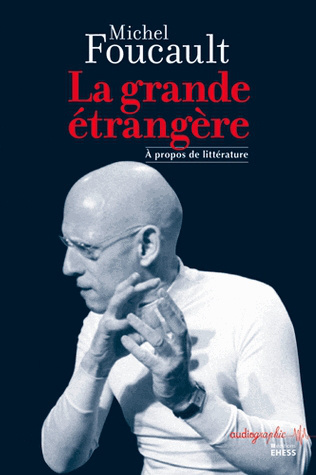
Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
221 pages
ISBN : 978-2713223860